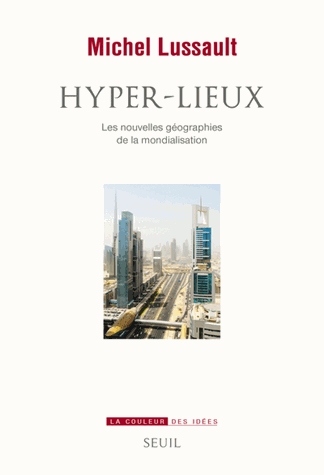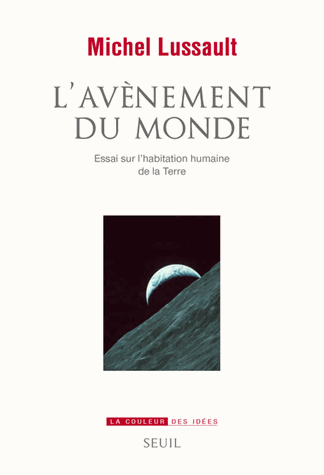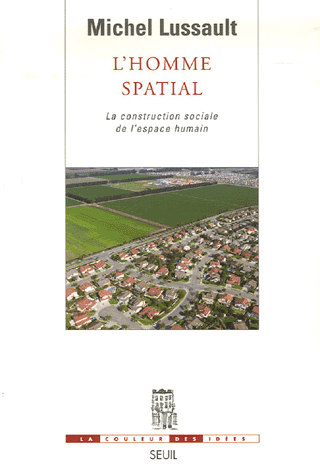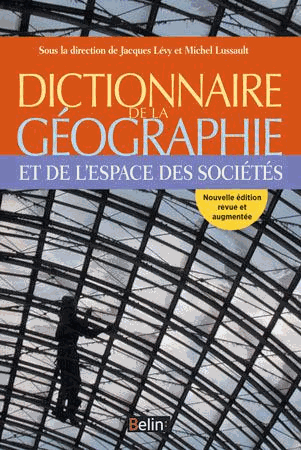«Le virus est un opérateur spatial. Il nous menace, mais il fait lien»
Le géographe Michel Lussault nous invite à inventer les sciences de la ville dans notre système urbain mondialisé à partir de et avec les opérateurs non humains que sont, entre autres, les virus.
Espazium: Vous aviez analysé l’épidémie de SRAS en 2003, dont vous parlez dans votre ouvrage L’Homme spatial (2007), et vous vous dites passionné des virus. En tant que géographe, qu’est-ce qui vous intéresse tant dans ces micro-organismes?
Michel Lussault; Deux choses m’intéressent. D’abord, au début des années 1990, je me suis posé la question de savoir comment ce qu’on n’appelait pas encore les non-humains pouvaient être considérés comme des protagonistes ou des opérateurs, ou encore des actants au sens de Bruno Latour[1], puissamment engagés dans le fonctionnement des sociétés et dans l’organisation des espaces sociaux, à toutes les échelles. En tant que géographe, je voulais aller chercher un opérateur non humain que l’on considérait comme en dehors du champ de la géographie et de la réflexion sur l’espace social. J’en suis donc venu très vite à m’intéresser aux virus et aux bactéries.
Le virus est en relation avec nous, il agit et il nous force de façon spectaculaire à réagir: en quelque sorte, c’est lui qui guide l’interaction. Il n’a pas d’intentionnalité autre que celle du vivant, autrement dit assurer sa viabilité. Son but est de se déployer. Aujourd’hui, nous allons toujours plus loin dans la possibilité de contrôler le vivant. Mais à travers la manifestation de certaines pandémies comme le HIV, les grippes, Ebola dans les années 1970, est-ce que les virus ne montrent pas à quel point cette maîtrise du vivant se heurte à la dynamique propre du vivant? Le virus vient en quelque sorte vriller cette volonté de contrôle et nous oblige à changer notre manière de considérer les systèmes de relations et d’interdépendance entre les humains et les non-humains, ce qui permet aussi de commencer à symétriser[2] les points de vue.
D’autres s’intéressent à la question de la même manière, notamment un anthropologue extraordinaire, Frédéric Keck, qui va publier un livre sur la grippe aviaire, Les sentinelles des pandémies[3]. Il y examine la façon dont Hong Kong, Singapour et Taïwan se sont organisés pour surveiller l’éventuelle diffusion de l’épidémie de grippe aviaire à partir de la Chine, à la suite du SRAS qui avait fait peur à tous les pays de la région. Ces mêmes pays se sont d’ailleurs révélés très réactifs dans la gestion de l’épidémie de Covid-19, tout comme le Japon et la Corée. Baptiste Morizot, qui travaille sur les loups[4], parle des « nouvelles diplomaties » entre humains et non-humains. Avec les virus, il y a bien une diplomatie à inventer, qui serait aussi une géopolitique, c’est-à-dire une réflexion sur ce qu’il est possible de faire ou non en termes de partage des espaces et des usages entre les parties: je confine ou je ne confine pas, j’entrave la circulation ou pas, je teste tout le monde ou pas. C’est tout ce qui distingue le traitement de l’épidémie par la Chine, la Corée, Singapour, l’Italie, les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne.
Le virus nous permet de comprendre comment nous cohabitons le monde, en sortant du point de vue humano-centré, en pensant aussi à partir et avec du non-humain. Cette crise nous permet de le faire, mais je propose que nous le fassions tout le temps, même en mode normal. Il y a aussi des antécédences, c’est aussi pour cela qu’on redécouvre les pensées des peuples autochtones, des peuples indigènes, qui savaient regarder l’humain à partir du non-humain.
Ces réflexions étaient-elles déjà d’actualité lors de l’épidémie de SRAS en 2003?
L’épidémie de SRAS est l’une de celles qui a peut-être le plus compté dans le redéveloppement de l’intérêt pour les virus. Mais il faut bien reconnaître que depuis très longtemps les sciences sociales s’intéressent aux bactéries, aux bacilles, aux micro-organismes, parce que les sociétés ont toujours été hantées par cette menace. Sans même remonter à la peste et au choléra, dans le domaine des sciences de la ville, l’hygiénisme a constitué une première volonté de se donner un corpus pour lutter contre les troubles provoqués par des organismes vivants qu’il faut maîtriser. Ce n’est sans doute pas pour rien non plus que quelqu’un comme Bruno Latour a consacré un livre à Pasteur[5] et que pendant toute l’histoire des sciences sociales et des sciences de la ville qui accompagnent la naissance de la ville aux 19e et 20e siècles, la question des pathologies est si importante.
En revanche, ce qui me paraît un peu nouveau depuis une vingtaine d’années, et le SRAS y a contribué, c’est que nous sommes sortis de la phase où on s’intéresse aux questions d’épidémies en tant qu’elles menacent l’ordre social et qu’elles imposent des réponses d’ordre politique, de contrôle. Ces questions sont toujours importantes, mais à côté de cela, on voit émerger dans une certaine science sociale la volonté de se servir du virus comme d’un élément de compréhension de la manière dont on habite, plus exactement les façons dont humains et non-humains cohabitent les systèmes biophysiques.
Vous avez parlé d’un second motif d’intérêt pour les virus.
Oui. Le virus est un opérateur spatial, qui est aussi un formidable indicateur de la mise en place du monde comme système, procédant du déploiement de l’urbanisation comme vecteur. Le SRAS m’intéressait en 2003 parce qu’il montrait l’importance de l’urbanisation pour l’organisation de l’espace. Le Covid-19, c’est le SRAS facteur N. On voit à quel point en 15 ans, le système monde s’est noué de plus en plus, à quel point l’urbanisation a créé des enchevêtrements hyperscalaires, à la fois micro-locaux et globaux. D’ailleurs, au sens propre, notre corps est traversé par ça. Si nous contractons le virus, c’est une partie de cette mondialisation que nous incorporons. Comment se fait-il que ce virus qui se manifeste d’abord dans la région de Wuhan, et qu’on retrouve dans un marché où il y a des échanges d’animaux, sans qu’on sache s’il s’agit de son lieu d’origine ou simplement d’un premier espace de concentration, provoque la plus forte crise sanitaire globale et qu’aujourd’hui, moi, à Lyon, je suis confiné? C’est inexplicable si on n’a pas une pensée du système: ce qui se passe à Wuhan se passe ici, de manière pratiquement synchrone, en quelques semaines, et nous le suivons jour après jour, heure après heure, en continu. Oui, ça bouleverse notre manière de concevoir notre organisation collective des espaces de vie à toutes les échelles en même temps, en particulier les géopolitiques classiques d’État. Voyez à quel point les frontières sont à la peine. Elles ne sont pas tant réactivées parce que ce serait vraiment utile pour lutter contre le virus, que parce qu’on ne sait pas comment faire autrement pour rassurer les populations.
Les virus circulent dans le système monde, mais sont aussi des opérateurs de liens. Le Covid nous menace, mais il fait lien, il fait système. Pour moi, c’est une première occasion de vivre à l’échelle de la planète, en temps réel, une émergence systémique de cet ordre. En apparence, le virus démondialise, on voit bien d’ailleurs comment les chantres de la démondialisation s’engouffrent dans cette porte. Mais du même mouvement, il montre à quel point le système est puissant. Plutôt que démondialiser, le virus pourrait altermondialiser, faire évoluer le système vers un autre état de relative homéostasie provisoire. Cette crise pourrait être un élément de réorientation, plus puissant encore que ne l’a été la crise de 2008.
Vous avez évoqué l’hygiénisme, qui a produit un certain nombre de figures urbaines très marquantes – les cités jardins, les typologies du mouvement moderne – dont on est encore les héritiers aujourd’hui. Comment la prise en compte de ces opérateurs non-humains peut-elle influer sur nos manières de penser l’espace de nos territoires, de nos quartiers, de nos bâtiments?
Je vais essayer de vous répondre, mais la question est redoutable. Nous n’avons pas encore inventé les lexiques géopolitiques et les modes de fonctionnement sociaux et d’organisation de nos usages de l’espace qui pourraient aller avec cette nouvelle habitation conjointe par les humains et les non-humains de cette même planète Terre. En réalité, nous réagissons encore avec les outils qui sont ceux de la vieille quarantaine, même s’il y a quelques exceptions dont nous avons parlé.
Dans son livre Les sentinelles de l’épidémie, Frédéric Keck met en tension prévention et préparation (preparedness). La prévention renvoie aux vieux outils classiques de l’ingénierie des risques: face à une menace extérieure, il faut en faire la prévention et l’éradiquer par une politique de traitement post-préventif. La préparation, quant à elle, intègre le point de vue des non-humains dans la réflexion sur la façon dont une crise adviendra. Pour moi, la véritable préparation doit aussi comprendre que la vulnérabilité vient de l’intérieur. Avec le Covid-19, on considère que la menace vient de l’extérieur, c’est pour cette raison qu’on ferme les frontières. Mais la menace ne vient de l’extérieur que si on a une vision totalement moderne de la relation entre humains et non-humains; si vous avez une vision non moderne au sens de Latour, vous comprenez que les non-humains sont toujours avec nous. Nous avons un rapport d’interdépendance réciproque, presque de fraternité, de socialité. Dans ce cadre, une flambée épidémique devient un changement du régime relationnel, qui demande de réviser momentanément la diplomatie. Ce qui ne signifie pas couper toute relation parce que ce n’est tout simplement pas possible. Il faut donc apprendre à vivre avec les virus qui seront d’une manière ou d’une autre toujours là. Si ce n’est pas ce coronavirus là, ce sera un autre, parce que nous savons qu’il y en aura d’autres.
Cette crise nous renvoie à notre état permanent d’impréparation. Pour arriver à cet état de préparation, il nous faudrait réinventer les sciences de la ville anthropocène, même les inventer, de même qu’au 19e siècle nous avons inventé les sciences de la ville. Et nous en sommes encore à vivre sur les fondements de cette invention, avec cet artefact très particulier que sont l’architecture et l’urbanisme de la worldcity, cette ville sous stéroïdes que nous connaissons depuis 30 ans.
Y a-t-il des modèles vers lesquels on peut regarder aujourd’hui, dans l’histoire, sous d’autres latitudes, dans certaines sociétés, ou faut-il vraiment tout inventer?
On voit de nombreuses expérimentations, des choses intéressantes dans le domaine de la réflexion sur l’habitat partagé, la construction sobre, l’architecture bioclimatique, la remise en question des modèles de propriété, mais qui ne sont pas à mon sens à l’échelle des problèmes que nous avons à régler. La difficulté, c’est que nous devons inventer les sciences urbaines anthropocènes dans un monde à 8 milliards et bientôt 10 milliards d’habitants, dont 7 habitent en ville. Le monde est gorgé d’humains et il faudra bien faire avec.
Je pense qu’il est complètement déraisonnable d’en appeler à la catastrophe ou à l’effondrement pour pouvoir espérer inventer autre chose. L’effondrement, c’est une paresse de la pensée. Si l’on voulait suivre la philosophie de John Dewey sur l’éducation par l’action, nous devrions petit à petit comprendre qu’il nous faut apprendre collectivement des nouvelles situations anthropocènes, c’est-à-dire considérer que notre vie au jour le jour est en elle-même une situation d’apprentissage individuel et collectif qui va nous permettre d’affronter les situations de vulnérabilité et de proposer de nouvelles pistes et perspectives. Nous ne sommes plus dans une logique d’adaptation, nous sommes confrontés à une nécessité de réorientation.
Il faut sans doute aussi recomposer des ensembles de savoirs plus ouverts, protéiformes et polyvalents. Nous agissons aujourd’hui dans nos conteneurs disciplinaires, alors que nous avons besoin de plateformes d’interaction, d’échanges, de polyvalence, de confrontations.
Vous pensez que nos gouvernants devraient aussi écouter d’autres paroles que celle des seuls épidémiologistes?
Oui, bien sûr. Mais peut-être ne faut-il pas tout attendre des gouvernants… Je suis surtout déçu par notre incapacité, en tant que cohabitants, à considérer que ces choses-là nous concernent. Rien ne se fera sans un processus d’empowerment des individus, qui doivent arrêter de se considérer comme les clients d’une machine politique qui est là pour les servir. Inventer d’autres manières de vivre, c’est déjà considérer que nous sommes tous concernés par nos espaces de vie en commun. Et il reste un énorme travail à faire dans ce domaine.
Michel Lussault est géographe, professeur d’études urbaines à l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS) et directeur de l’École Urbaine de Lyon (EUL), projet interdisciplinaire expérimental de recherche, de formation doctorale et de valorisation économique, sociale et culturelle des savoirs scientifiques autour de l’urbain anthropocène.
À écouter également les Chroniques géovirales de Michel Lussault où il propose une analyse de la situation liée à la pandémie de COVID-19 en suggérant d’en faire un événement anthropocène total.
Notes
[1] Bruno Latour et Steve Woolgar, La Vie de laboratoire, Paris, éditions La Découverte, 1988
[2] Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, essai d’anthropologie symétrique, éditions La Découverte, 2006
[3] Frédéric Keck, Les Sentinelles des pandémies, Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine, éditions Zones sensibles, à paraître.
[4] Baptiste Morizot, Les Diplomates: Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Wildproject Éditions, 2016
[5] Bruno Latour, Pasteur: guerre et paix des microbes, Paris, éditions La Découverte, 2012
Dossier COVID-19 - Liste des témoignages:
- Guy Nicollier, Pont12 Architectes, Chavannes-près-Renens
- Laurent de Wurstemberger, LDW Architecte, Genève
- Simon Chessex, Lacroix Chessex, Genève
- Patrick Aeby, Jan Perneger et Michel Rollet, Aeby Perneger & Associés SA, Carouge
- Michel Lussault, directeur de l’École Urbaine de Lyon (EUL)
- Nicolas de Courten, NICOLAS DE COURTEN architectes EPF SIA, Lausanne
- Enrique Zurita, président de la SIA Vaud, directeur Weinmann-Energies, Echallens
- Julia Zapata, Philippe Bonhôte et Mathieu Rouillon, Bonhôte Zapata architectes, Genève
- (à suivre)
La culture du bâti face à l’urgence du Covid-19 - La parole aux professionnels
La crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement frappe l'ensemble des secteurs professionnels et notamment celui du bâti. Pour évaluer l'impact de cette urgence dans le domaine de l'architecture, Espazium donne la parole aux professionnels du domaine afin qu’ils témoignent de manière personnelle de leur nouvelle organisation, de leur difficulté et – puisque toute crise révèle les forces mais également les failles des systèmes – qu’ils nous fassent part de leurs réflexions sur leur métier. Pour ne pas oublier, et dans l’espoir que ces témoignages aideront à mener une véritable réflexion de fond afin que tout ne redevienne pas comme avant une fois que le virus aura été vaincu.
Retrouvez tous les articles en lien : Dossier COVID-19